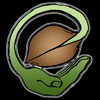MÉDIAPART – Légaliser le cannabis (5/6). L'exemple de l'Uruguay inspire l'Amérique latine
20 août 2014, 14:57
20 août 2014 | Par Karl Laske - Mediapart.fr
URL source: www.mediapart.fr/article/offert/3ea7804 ... f900f22396
URL source via CIRC fb : https://www.facebook.com/notes/circ/m%C ... 3075863514
La loi prévoyant le contrôle par l’État de la production et de la vente de cannabis entre en application. L’exemple uruguayen provoque un mouvement en faveur de la légalisation au Mexique, au Brésil, au Chili, en Colombie et en Argentine.
« Quelqu’un doit être le premier », a dit le président uruguayen José Mujica en juin 2012, lors de l’annonce de son projet de production et vente de cannabis par l’État en Uruguay. « Quelqu’un doit commencer en Amérique du Sud, parce que nous perdons la bataille contre les drogues et le crime sur le continent. » « Je fais ça pour la jeunesse, parce que les approches traditionnelles n’ont pas donné de résultat, a explicité Mujica. Il faut chercher un autre chemin, même si beaucoup le considèrent audacieux. Nous sommes un petit pays où l’on peut faire les choses avec facilité. »
C’est donc l’audace d’un petit pays – 3,2 millions d’habitants –, qui a déjà été le deuxième au monde à instaurer l’éducation obligatoire, en 1877, et l’un des premiers à permettre le divorce, en 1917. Selon un sondage réalisé en mai dernier, l’opinion publique uruguayenne désapprouve pourtant l’initiative à hauteur de 64 %, mais 46 % seulement se déclare favorable à sa remise en cause, préférant voir les résultats. Les élections présidentielles et législatives d’octobre prochain ouvrent de fait la possibilité d’une marche arrière, souhaitée par l’opposition, mais l’ex-président Tabaré Vázquez, candidat de la gauche et favori des sondages, devrait poursuivre la réforme.
« Nous ne sommes pas en train de proposer une légalisation qui permette à chacun d’aller dans un commerce acheter des quantités de marijuana, et faire ce qu’il veut avec, a précisé Mujica. L’État va contrôler la qualité, la quantité, le prix et les personnes seront enregistrées. »
L’idée vient de Mujica lui-même. L’ancien guérillero du Mouvement Tupamaros, écroué durant les douze années de la dictature (1973-1985), est devenu président de la République en mars 2010, après avoir été sénateur (Movimiento de Participación Popular), et un temps ministre de l’agriculture de Tabaré Vázquez (2005-2008). En 2009, son programme électoral n’évoque pas le projet d’une légalisation du cannabis, mais propose de « discuter de la politique nationale en matière de drogues ».
« La direction à prendre n’était pas très claire, a expliqué Sebastián Sabini, député (Frente amplio) au cœur de ce dossier, au journal argentin la Letra P. Nous pensions à une certaine forme de régulation par l’auto-culture ou les clubs qui modifierait la situation d’insécurité juridique. Puis il y a eu un dossier charnière. En janvier 2011, Alicia Castilla, une femme de 70 ans, a été inculpée pour la détention de quelques plantes, et détenue plus de 100 jours. Cela a cassé un peu l’idée préconçue de qui sont ceux qui fument, et cela eu un impact très grand en Uruguay. »
La grève de la faim d’Alicia Castilla et le recours qu’elle engage devant la Cour suprême pour sa remise en liberté provoquent le débat sur la prohibition. « Cela a donné un cadre au projet que nous avions d’une régulation de l’auto-culture, l’usage médical, industriel, scientifique, et les clubs de cannabis, mais cela n’incluait pas la vente, poursuit Sebastián Sabini. C’est au moment où nous allions commencer le débat en commission, que Pepe (José Mujica) est arrivé avec son initiative de réguler le marché, et tout a changé. »
Plus d’un an s’écoule, de réflexions et d’études, avant la première annonce du président uruguayen, en juin 2012. L’idée, a priori simple, est d’offrir un circuit légal, une marijuana d’État, aux consommateurs. Et de couper ainsi l’herbe sous le pied des trafiquants…
Dans la pratique, la création de la totalité de la chaîne est un véritable casse-tête, vu la multiplicité des acteurs de la future industrie. En amont, l’État va délivrer des autorisations de production – licences – à des entreprises pour une superficie totale de 10 hectares environ. La commercialisation est confiée aux pharmacies qui le souhaitent, et doivent s’enregistrer. En aval, les consommateurs, résidents âgés de 18 ans et plus, doivent eux aussi s’inscrire, ce qui leur donne une possibilité d’achat à hauteur de 40 grammes par mois – ou 10 par semaine. Le législateur prévoit d’assurer l’anonymat aux consommateurs qui pourront valider leur achat par leur empreinte digitale. Les plus actifs pourront s’orienter sur l’auto-production, dans la limite de 6 plants par personne, ou les clubs, à raison de 99 plants par club.
« Pourquoi prendre des risques si le marché légal m'offre la qualité la sécurité, et le même prix ? »
Ce scénario a été inscrit dans la loi, approuvée en juillet 2013 par les députés, puis en décembre 2013, par les sénateurs. L’entrée en vigueur est effective depuis le 6 mai 2014, date de la mise en place de l’Institut de régulation et de contrôle du cannabis (IRCCA).
Initialement envisagée à l’automne 2014, la mise en route de la chaîne de production a finalement pris du retard. Le 1er août, l’IRCCA a ouvert son appel d’offres aux entreprises intéressées, qui avaient jusqu’au 18 août pour se porter candidates à l’attribution d’une licence d’une durée de 5 ans. Cinq postulants seront choisis afin de produire, chacun, une à deux tonnes de cannabis destinées aux pharmacies. Les producteurs devront cultiver des plants 100 % féminins – la plante mâle qui a un faible niveau de principe actif ne se fume pas –, et être en mesure de livrer leur cannabis, de manière échelonnée, tous les quinze jours aux pharmacies, tout au long de l’année.
La culture doit s’effectuer sur des terrains mis à disposition par l’État dans le département de San José, et avec des semences fournies par l’IRCCA. Le conditionnement doit s’effectuer par paquets de 5 à 10 grammes, et offrir aux consommateurs quatre niveaux de concentration en THC (TétraHydroCannabinol, la molécule provoquant les effets psychotropes) allant de 5 à 14 %.
Selon Julio Calzada, l’un des cerveaux de la réforme, secrétaire général de la Junta nacional de drogas, le prix de vente envisagé par l’État pour sa marijuana tournerait autour de 20 à 22 pesos le gramme (environ un dollar), soit un prix voisin, voire inférieur à celui du trafic, provenant pour l’essentiel du Paraguay. En Uruguay, le nombre de consommateurs occasionnels est estimé entre 120 000 et 200 000 personnes – selon les sources officielles ou associatives. Et 20 000 personnes seraient des fumeurs quotidiens.
« Pourquoi opter pour le marché noir s’il représente des risques, pour un produit de mauvaise qualité, alors que le marché légal m’offre la qualité et la sécurité, et que le prix est le même ? » a souligné Julio Calzada.
L’État, qui va soumettre cette activité à l’impôt, a écarté l’application d’une TVA sur le cannabis, pour garder un prix compétitif. Mais le tarif annoncé par le gouvernement serait largement sous-évalué, compte tenu des investissements nécessaires au lancement de la production. Une marge de 30 % sur les ventes est en outre promise aux pharmaciens.
La loi ne réglemente pour l’instant que l’usage récréatif du cannabis. Un choix « pragmatique » selon Sebastián Sabini : « 95 % des usagers ne fument pas parce qu’ils ont un cancer, qu’ils ont mal à la cheville ou qu’ils souffrent d’arthrose », commente le député. Il était donc « réaliste », sans être plus facile, de légiférer en premier l’usage récréatif. « Viennent ensuite les utilisations politiquement plus correctes. L’usage médicinal est celui sur lequel on travaille actuellement. »
Qu’il choisisse l’auto-culture, l’achat en pharmacie ou l’inscription à un club, le consommateur devra s’inscrire sur le registre national d’usager détenu par l’IRCCA. Une entreprise informatique a été chargée de la mise au point et de la sécurisation de ce fichier – en vertu de la loi de protection des données personnelles. Les pharmacies doivent pouvoir vérifier les numéros d’inscription des usagers via un système de vérification des empreintes digitales, sans avoir accès aux données personnelles du consommateur. L’inscription, avec relevé d’empreintes, s’effectuera dans les bureaux de poste des villes de plus de 10 000 habitants.
L’inscription n’est pas encore possible. Par contre, les clubs ont été invités à se préinscrire. Jusqu'à présent, ils fonctionnaient clandestinement en coopérative, assurant des formations à la culture, l'approvisionnement en semences, etc. Plusieurs d’entre eux – Associacion de estudios del Cannabis en Uruguay, AECU, La hoja roja… – ont fait état récemment de leurs préparatifs pour démarrer leur activité légale, et de l’arrivée en ville de la marijuana auto-produite. « Il y a une explosion de culture qui inonde les bars de Montevideo de fleurs de marijuana meilleures que n’importe quel produit paraguayen », raconte le président de la fédération des cannabiculteurs, Julio Rey, au quotidien La Nacion.
Le plan de José Mujica se met donc en place. Alors que l’opposition dénonce « l’expérimentation » dans laquelle il engage le pays, elle a relevé la déclaration du milliardaire George Soros, en septembre 2013, lors d’une rencontre avec Mujica : « Nous sommes conscients que l’Uruguay va être un laboratoire, et que si l’expérience s’avère satisfaisante, elle pourra bénéficier au monde entier. » Ce soutien inattendu à Mujica a fait de Soros l’un des épouvantails de ce débat. L’Open Society Foundation (OSF) de Soros a soutenu financièrement l’organisation du Débat national sur les drogues en 2011 puis la campagne publicitaire télévisée « Régulation responsable » en soutien du projet de loi de légalisation, en 2013.
L’implication de Soros dans le développement des agrocarburants dans la région – à travers la firme Adecoagro qui possède 340 000 hectares entre l’Argentine, l’Uruguay et le Brésil – a fait craindre son intervention sur le marché uruguayen du cannabis. Mais Soros a précisément bien assez d’affaires en cours, pour s’intéresser à un marché aussi encadré par l’État.
« L’enjeu est aujourd’hui l’utilisation de toutes les plantes maîtresses pour la santé publique »
En six mois, la loi uruguayenne a provoqué un mouvement en faveur de la légalisation dans plusieurs pays d'Amérique latine, par des appels au débat et des dépôts de projets de loi au Mexique, au Brésil, au Chili, et tout récemment en Argentine, où la présidente a donné son feu vert à l’examen d’une modification de la loi.
En février, ce sont des sénateurs mexicains du Partido revolucionario democrático (PRD, gauche) qui ont déposé une proposition de loi visant à dépénaliser un peu plus la consommation personnelle – en portant la dose maximale autorisée de 5 à 30 grammes – et à favoriser l’usage médical de cannabis. L’initiative accompagne l’étude d'un projet de régulation de la consommation sur le district fédéral de Mexico.
En août 2013, l’ancien président mexicain Vicente Fox, du Partido de Acción nacional (PAN, conservateur), avait déjà salué l’avancée institutionnelle opérée par l’Uruguay, « à l’avant-garde de l’Amérique latine », et appelant de ses vœux une opération similaire à México. Et l’on a vu récemment un élu du PAN soutenir l’initiative du PRD. « Réguler n’est pas promouvoir la consommation, au contraire, c’est faire que l’État puisse jouer un rôle plutôt que laisser la délinquance décider de tout dans un marché qui va continuer d’exister », a déclaré le sénateur Mario Delgado (PRD), reprenant au mot près les explications uruguayennes.
L'un des objectifs de la proposition est de décentraliser la politique de drogue au niveau fédéral, pour être en mesure d’assurer la distribution de marijuana dans des « lieux d’approvisionnement sûrs », sous l’autorité du district fédéral. L’Institut d’accueil et de prévention des addictions de la ville de Mexico (IAPA) pourrait être chargé de cette tentative de régulation. Le projet du PRD vise aussi à obtenir la libération anticipée de détenus à Mexico, mis en cause pour leur consommation ou des trafics de cannabis portant sur des quantités inférieures à 300 grammes.
Le mouvement de libéralisation aux États-Unis influence par ailleurs les milieux politiques conservateurs. « Ce serait une bêtise, alors que les États-Unis légalisent la marijuana dans plusieurs États, que nous n’abordions pas le sujet, que nous le criminalisions, que nous remplissions les prisons de vendeurs de cannabis qui ont pour objectif de l’amener là où elle est légale », a déclaré l’ancien président de la chambre de députés, Francisco Arroyo (Partido revolucionario institucional, PRI).
Le débat a été lancé aussi au Brésil, par le député médiatique Jean Wyllys (PSOL, gauche), qui a présenté un projet de loi reprenant d’assez près l’exemple de « régulation » uruguayen. Wyllys préconise la libéralisation de la culture pour la consommation personnelle, limitant à six le nombre de plantes cultivées, avec une inscription obligatoire sur un registre officiel, et de possibles inspections. Il plafonne comme en Uruguay la consommation à 480 grammes par an, et donne à l’exécutif la responsabilité de définir des zones de culture.
Plusieurs pays latino-américains ont déjà acté des dispositions de tolérance en cas de détention de petites quantités de marijuana, mais ces dispositions n’empêchent pas la répression.
Sur les 13 145 détentions liées au commerce de la drogue en 2013 au Pérou, seulement 37 % le sont pour des délits aggravés. « 62 % sont détenus pour possession de drogue ou consommation, alors même que la consommation n’est plus un délit dans notre code pénal, explique Ricardo Soberón, avocat et ancien chef d’un des organismes de lutte contre la drogue, la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas (DEVIDA). Nous travaillons sur une proposition de directive destinée aux commissariats, pour que la police distingue les consommateurs des personnes impliquées dans le trafic. »
Au Pérou, on peut légalement disposer jusqu’à 8 grammes de cannabis, mais la culture et la commercialisation sont encore sanctionnées par des peines allant de 8 à 15 ans de prison. Le Centre de recherche drogues et droits de l'homme (CIDDH) animé par Soberón a créé un accueil téléphonique – la « linea verde » – pour venir en aide aux interpellés. « Notre avocat intervient, poursuit Soberón. Il est facile pour les policiers de dire qu’ils soupçonnent le consommateur de trafic. Il arrive qu’entre l’arrestation et l’arrivée du procureur, les policiers sollicitent une somme d’argent pour surseoir à la procédure. »
Nommé par le président Ollanta Humala, Ricardo Soberón a été contraint de quitter la direction de la DEVIDA après avoir stoppé une opération d’éradication de culture de coca sous contrôle américain, et provoqué un clash avec l’ambassadeur des États-Unis.
En janvier dernier, Soberón a salué le vote de la loi uruguayenne, et appelé les autorités à l’ouverture d’un débat. L’avocat estime qu’au-delà du cannabis, l’enjeu est aujourd’hui « l’utilisation de toutes les plantes maîtresses pour la santé publique » : « la feuille de coca, le San Pedro (cactus), l’ayahuasca (plante amazonienne) et l’amapoya (le pavot) ». « Mais je suis réaliste : dans mon pays, il faut un débat, informé, scientifique, vrai, explique-t-il. Je préfère parler de régulation, plus que de légalisation. Je ne crois à la répression que pour les grandes structures du crime organisé. »
Le Chili, l'Argentine et la Colombie prennent le chemin des réformes
Au Chili, qui vient d’autoriser, en juillet, l’arrivée du Sativex, médicament à base de Cannabis sativa, les statistiques renvoient le même diagnostic qu’au Pérou : la consommation reste pénalisée bien que la loi l’accepte. Sur 85 000 détenus dans des affaires de drogue, 18,3 % le sont pour trafic aggravé, et 77,6 % pour simple détention, consommation ou culture.
Au premier semestre, le débat chilien a été marqué par la grève de la faim d’un psychiatre, Milton Flores, condamné, en 2013, à 541 jours de prison avec sursis pour avoir cultivé des plants de cannabis. La Cour suprême avait cassé sa première condamnation en soulignant que ces cultures s’inscrivaient dans son activité professionnelle, et à des fins curatives, notamment concernant les problèmes d’addiction. Mais le parquet avait maintenu les poursuites, jugeant que ces cultures avaient été réalisées sans autorisation. Une vingtaine de parlementaires ont appuyé la saisine par Milton Flores de la Commission interaméricaine des droits de l’homme.
Courant juillet, trois députés d’Amplitud (droite) ont déposé un projet visant à légaliser l’auto-culture du cannabis. « L’objectif est d’autoriser l’auto-culture en vue d’une consommation privée, personnelle ou collective, et de proscrire la vente », a expliqué Karla Rubilar, l’une des trois élus. L’initiative a reçu l’appui des députés démocrates chrétiens (DC). « Nous disons oui à l’usage du cannabis à des fins thérapeutiques, à des fins récréatives, a commenté Matías Walker (DC), mais non au narcotrafic. Ce projet de loi peut nous permettre de faire perdre ce marché aux narcotrafiquants. » Les arguments de l’Uruguay ont porté partout.
C’est en Argentine que l’impact de l’initiative uruguayenne semble avoir été le plus décisif. Ces tout derniers jours, la présidente Cristina Fernández de Kirchner a donné son feu vert à l’élaboration d’une série de mesures visant à dépénaliser l’usage des drogues. Ces propositions doivent être étudiées par le service de lutte contre d’addiction et le narcotrafic (Secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción y la Lucha contra el Narcotráfico, Sedronar) afin d’être présentées au congrès avant la fin de l’année, dans l’objectif d’une réforme de la loi sur les stupéfiants.
Cette loi prohibe l’usage de toutes les drogues, mais une décision de la Cour suprême a considéré en 2009 qu’un de ses articles concernant la consommation était inconstitutionnel, et a décriminalisé la détention de petites quantités, jugeant nécessaire, en outre, la révision de la loi. Faute de révision, les policiers continuent d’appliquer la loi, face à des consommateurs qui, lorsqu’ils ont des avocats, invoquent la jurisprudence de la Cour suprême pour éviter l’incarcération.
Le 3 mai dernier, la Marche mondiale de la marijuana a réuni près de 150 000 manifestants à Buenos Aires. En tête du cortège, ce mot d’ordre qui fait le tour de l’Amérique latine : « No mas preso por cultivar, Regulación del cannabis, ya ! » – « Plus jamais détenu pour cultiver, Régulation du cannabis, maintenant ! ». La régulation voulue par les militants n’est pas celle de l’État cultivateur uruguayen, mais plutôt celle des clubs sociaux maîtrisant l’accès au cannabis et aux semences.
Fin juillet, la ministre argentine chargée de la sécurité María Cecilia Rodríguez a déclaré qu’elle était « favorable à la dépénalisation de la consommation », « avec l’encadrement nécessaire ». Récemment nommé secrétaire pour la réflexion nationale, le philosophe Ricardo Forster, animateur du club Carta abieta, a lui aussi fait savoir début août qu’il était « d’accord avec la dépénalisation parce que la logique répressive n’a abouti à rien ».
Les 12 et 13 août, Julio Calzada, le secrétaire de la Junta nacional de drogas uruguayenne, a été invité à un colloque sur la lutte contre la drogue à Bogota. Et devant lui, le président colombien Juan Manuel Santos a annoncé qu’il allait soutenir la proposition du sénateur Juan Manuel Galán visant à autoriser l’usage médicinal du cannabis. « Nous voyons avec bienveillance l’initiative sur l’utilisation thérapeutique et médicinale du cannabis, a-t-il déclaré. C’est une manière d’empêcher des criminels d’être les intermédiaires entre le patient et la substance qui va soulager sa souffrance. C’est un pas dans la bonne direction. »
Deux experts israéliens se sont précisément rendus à Montevideo pour suggérer à Calzada que l’État uruguayen étudie aussi la possibilité de devenir l’un des acteurs mondiaux du cannabis médicinal. Il pourrait être ainsi « le premier » à fournir à l’industrie pharmaceutique internationale un produit sûr, issu de ses cultures. Mais il faut d’abord qu’il légifère sur ce type d’utilisation.
URL source: http://www.mediapart.fr/journal/interna ... que-latine
MÉDIAPART – Légaliser le cannabis (5/6). L'exemple de l'Urug
Modérateur: Aide-Modérateur
1 message
• Page 1 sur 1
MÉDIAPART – Légaliser le cannabis (5/6). L'exemple de l'Urug
Les nanas sont de sortie !
Jdc Bambata tikiseedbank !
FxYxS
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Les temps changent mais pas la loi !
DONNEZ-NOUS LE POUVOIR
Jdc Bambata tikiseedbank !
FxYxS
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Les temps changent mais pas la loi !
DONNEZ-NOUS LE POUVOIR
-
























jack1 - Extracteur en chef

- Messages: 10693
- Images: 10
- Âge: 11
- Inscription: 02 Juil 2002, 21:45
- Dernière visite: 27 Mai 2025, 21:10
- Localisation: 420 rue marijane -ganjaland
- Sexe:

-
- Karma: 3750
1 message
• Page 1 sur 1
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 3 invités