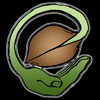MÉDIAPART – Légalisation du cannabis (4/6). Les impasses de la « guerre contre la drogue »
17 août 2014, 17:56
17 août 2014 | Par Iris Deroeux - Mediapart.fr
URL source: www.mediapart.fr/article/offert/466c926 ... 6e06d32e7f
URL source via CIRC fb : https://www.facebook.com/notes/circ/m%C ... 9602669528
Le mouvement de réforme des politiques en matière de cannabis signifie-t-il que la « guerre contre la drogue » américaine arrive à son terme ? Non, mais il indique bien une évolution voire un changement de paradigme, lent et encore brouillon, tant aux États-Unis qu’en Amérique latine. « Est-ce que les États-Unis mènent toujours la guerre contre la drogue ou est-on passé à autre chose ? Nous n’en savons rien », déplorait récemment l'ancien président colombien César Gaviria.
De notre correspondante aux États-Unis. « La guerre contre la drogue est-elle terminée ? », interrogeaient la New York University et la revue intellectuelle N+1 lors d’une conférence qu’elles organisaient à New York, en avril 2014. Autour de la table, trois spécialistes connus pour leur opposition aux politiques répressives, prônant des politiques de régulation des drogues et de traitement des usagers : l’ancien président colombien César Gaviria ; l’historienne Kathleen Frydl, auteur d'un ouvrage de référence sur la guerre contre la drogue ; et Hamilton Morris, chimiste et journaliste scientifique spécialiste des drogues de synthèse.
L'objectif de la conférence était d'évaluer l’impact du mouvement local de dépénalisation et de légalisation du cannabis sur la politique globale des États-Unis en matière de drogues. Ce que firent les trois experts, en résumant les enjeux et en pointant les limites du mouvement de réforme en cours, avant de donner une réponse simple à la question posée par le titre : non, la « guerre contre la drogue » n’est pas terminée.
Pour rappel, cette expression désigne un ensemble de politiques répressives condamnant sévèrement l’usage, la vente, la culture de plantes psychotropes et la fabrication de drogues de synthèse, qu’il s’agisse de cannabis, d’héroïne, de cocaïne ou de méthamphétamine, pour ne citer qu’elles.
Ses origines remontent au XIXe siècle, mais le terme de « guerre » fut définitivement adopté sous Richard Nixon (président des États-Unis de 1969 à 1974). L’époque est marquée par la guerre du Viêtnam, l’addiction à l’héroïne de nombreux soldats, les trafics de stupéfiants entre l’Asie et les États-Unis… Le président se saisit du problème en déclarant la « guerre » à la drogue, sans pour autant laisser de côté l’aspect social et médical du problème. Comme le souligne l’historienne Kathleen Frydl lors de notre entretien, à l’époque, les États-Unis investissent encore des sommes considérables dans le traitement de la toxicomanie.
En 1970, le Controlled Substance Act est adopté. Il devient la pierre angulaire de la loi américaine en matière de stupéfiants. Les drogues y sont classées en fonction de leur dangerosité et de leur utilité médicale, décrétées de manière subjective « pour des raisons politiques et historiques plutôt que scientifiques », note Kathleen Frydl. Dans la catégorie 1, figurent des drogues dont la possession est interdite, qui présentent un fort potentiel d’abus et n’ont pas d’intérêt médical aux yeux des autorités.
Y sont aujourd’hui classés la marijuana, l’héroïne, la MDMA, ou encore le LSD. Dans la catégorie 2, sont rangées des drogues considérées comme moins propices aux abus et utiles à des fins médicales reconnues, comme la cocaïne, l’opium, la morphine, la mépéridine (un opiacé de synthèse) ou encore la codéine. Selon leur catégorie, l’usage de ces drogues est ensuite plus ou moins sévèrement condamné. C’est la DEA (Drug Enforcement Agency), une agence fédérale créée en 1973, qui est chargée de faire respecter la loi, en collaboration avec les polices locales.
Cette approche pénale va se durcir sous la présidence de Ronald Reagan (1981-1989). Il crée le Bureau de la politique nationale de lutte contre les stupéfiants (Office of National Drug Control Policy), dont le directeur est plus communément appelé « Tsar de la drogue » (un titre popularisé notamment par Traffic de Steven Soderbergh, sorti en 2000). Dans les années 1980, deux lois viennent renforcer les sanctions fédérales qui s’appliquent aux délits liés aux stupéfiants. Se met alors en place un système pénal cumulant de sévères peines planchers et la « loi des trois coups », selon laquelle un délinquant condamné pour une troisième infraction, même mineure, se voit condamné à une peine allant de 25 ans de prison à la perpétuité.
Sous Ronald Reagan, les commissariats sont en outre encouragés à se financer grâce aux saisies de biens effectuées lors d’arrestations liées à la drogue. Par exemple, en conservant les voitures des conducteurs fouillés puis arrêtés pour possession de drogue. Ce système est toujours en place et, selon les chiffres du Bureau de la Justice, entre 2002 et 2012, les agences locales et fédérales ont ainsi collecté près d’un milliard de dollars grâce aux arrestations liées à la marijuana.
L’une des conséquences de ces politiques répressives est l’explosion de l’industrie carcérale américaine. Depuis les années 1980 et les débuts de la guerre contre la drogue, le nombre de prisonniers a quadruplé selon les chiffres de la Prison Policy Initiative, pour atteindre aujourd'hui 2,4 millions de prisonniers. Dans les prisons d'État, les personnes condamnées pour des crimes et délits liés à la drogue représentent 10 % de la population carcérale, c'est onze fois plus qu'en 1980. Dans les prisons fédérales, cette proportion s'élève désormais à 49,8 % des prisonniers.
En parallèle, un autre chapitre de la guerre contre la drogue s’écrit dans les pays producteurs de drogues, notamment en Amérique latine. Depuis les années 1970, les États-Unis y ont investi plus de mille milliards de dollars dans la lutte contre la production et le trafic de stupéfiants. Leurs efforts ont été menés par le biais d’agences fédérales établies dans les pays concernés, la DEA, mais aussi le FBI et la CIA. La DEA dispose aujourd’hui de 222 bureaux sur le sol américain et de 86 bureaux dispatchés dans 67 pays étrangers.
Uruguay, premier État à légaliser
Parmi les opérations connues, il y eut l’opération Condor lancée dans les années 1970 au Mexique, devant servir à éradiquer la culture de marijuana et de coca au nord du pays. Ce fut un échec : la production n’a fait que se déplacer temporairement dans d’autres États mexicains. Mais la politique américaine ne fut pas remise en cause. Au contraire, elle se généralisa. À partir des années 1990, le Plan Colombie fut lancé, un gigantesque plan d’aide financière et militaire ayant pour objectifs d’éradiquer les cartels et de bloquer les routes du trafic. Il se poursuivit jusque dans les années 2010, avant de se déplacer cette fois vers les pays d’Amérique centrale, où transite la drogue.
Ce sont désormais ces pays – en particulier le Guatemala et le Honduras – qui font l’objet de l’attention américaine. Les sommes investies ne cessent d’augmenter. Comme le résumait cette enquête d’Associated Press, en 2012, sur les 830 millions de dollars d’aide militaire et policière dépensés dans la région par les États-Unis, neuf dollars sur dix étaient destinés à lutter contre le narcotrafic, soit 30 % de plus que lors de la décennie précédente.
Sauf que cette approche militaire suscite de plus en plus de critiques en Amérique du Sud. En 2013, l’Organisation des États américains – qui regroupe les gouvernements des États du continent – publiait un rapport intitulé “Le problème des drogues en Amérique”, appelant à une réforme des politiques en matière de drogue et à la mise en place d’une approche moins sévère à l’égard des usagers. Des chefs d’État du Brésil, de Colombie, du Mexique, du Guatemala et d’Uruguay ont déclaré que la guerre contre la drogue était un échec et se sont prononcés pour des politiques alternatives, notamment la dépénalisation du cannabis. L’Uruguay l’a fait : en décembre 2013, il est devenu le premier État à légaliser le cannabis, en adoptant une loi régulant la chaîne de production de la plante étoilée entièrement sous autorité de l’État.
En outre, depuis que le Colorado et l’État de Washington ont légalisé l’usage récréatif du cannabis, des hauts fonctionnaires mexicains ne se privent pas de pointer les contradictions américaines. Ils se demandent pourquoi ils devraient continuer à allouer tant de ressources à combattre une drogue comme le cannabis quand celui-ci est légal, ici et là, de l’autre côté de la frontière.
Pour César Gaviria, président de la Colombie de 1990 à 1994, la politique américaine est désormais illisible. « Est-ce que les États-Unis mènent toujours la guerre contre la drogue ou est-on passé à autre chose ? Nous n’en savons rien. Regardez, il n’y en a même pas un qui a le courage de venir défendre la position du gouvernement dans ce genre d’événement », s’emporte-t-il lors de la conférence organisée à la New York University, en faisant référence à l’absence de Michael Botticelli, actuellement « tsar de la drogue » de Barack Obama, pourtant invité.
L’ancien président poursuit : « Aux États-Unis, il ne faut surtout pas trop parler de réforme pour ne pas paraître mou contre le crime. En Europe, c’est quasiment un non-sujet politique… Les chefs d’État sont dans le déni de réalité, ils choisissent la fuite ! Ils refusent de parler de drogues alors que ça fait des morts tous les jours, juste là, de l’autre côté de la frontière. »
L’administration Obama n’est pourtant ni totalement silencieuse ni totalement passive sur le sujet, en tout cas lorsqu’il s’agit de politique intérieure.
D’abord, elle a choisi de laisser faire le Colorado et l’État de Washington plutôt que de leur mettre des bâtons dans les roues, et a indiqué qu’elle observait avec attention comment ceux-ci géraient la légalisation du cannabis. Du côté de la recherche, les agences fédérales compétentes telles que la FDA et la DEA ont récemment accepté d’augmenter la quantité de marijuana qui pouvait être cultivée à des fins scientifiques.
La réforme de l’assurance santé d’Obama, dite Obamacare, est aussi considérée comme une avancée par les défenseurs d’une nouvelle approche en matière de drogue. En devant permettre à tous les Américains d’être médicalement couverts, et en élargissant l’accès à Medicaid (l’assurance santé publique réservée aux plus démunis), cette loi est censée faciliter le traitement des toxicomanes.
Dès sa prise de fonction, en 2009, Barack Obama a également fait voter une loi corrigeant le fonctionnement des peines minimum. Pour des raisons historiques, liées à l’hystérie suscitée par les ravages du crack dans les années 1980, la consommation de crack était bien plus lourdement condamnée que celle de cocaïne (alors que le crack est un dérivé de la cocaïne). Ce déséquilibre a donc été rectifié, et les peines légèrement diminuées.
Actuellement, au Sénat, une autre loi est en discussion afin de réduire et d’améliorer le système des peines pour les crimes et délits liés à la drogue : le Smarter sentencing act (loi pour des condamnations plus intelligentes) a été initié par des démocrates et des républicains partageant le même ras-le-bol face à l’hypercarcéralisation de la société américaine.
« C’est une loi importante, mais à l’impact limité. Si elle était votée, elle ne s’appliquerait qu’aux peines fédérales, alors qu’en matière de drogue, la plupart des délits sont jugés et condamnés par des cours locales, appliquant le droit local », analyse la chercheuse Kathleen Frydl.
Contrôle quasi colonial
Selon cette historienne, ces quelques réformes fédérales ne sont donc que « des petits pas », qui ne vont pas « véritablement transformer le régime de prohibition, toujours en place et intact ». Une situation qu’elle explique en revenant sur les racines de la guerre contre la drogue aux États-Unis (auxquelles elle a consacré son ouvrage, The Drug Wars in America, 1940-1973) et en s’intéressant non pas aux échecs de cette guerre, mais à ses succès.
Autrement dit, si l’approche ultra-répressive domine encore, quand bien même elle ne permettrait pas de faire baisser la consommation ni le trafic de drogue, c’est qu’elle atteint finalement d’autres objectifs. La chercheuse estime que la guerre contre la drogue permet surtout « d’exercer une forme de contrôle quasi colonial sur différents territoires ». À l’international, elle a permis d’« imposer le pouvoir américain dans des pays en voie de développement ». « Dans les années 1980 et 1990, la guerre contre la drogue fut la structure grâce à laquelle de l’argent et des ressources furent acheminés à des gouvernements alliés en Amérique latine », explique-t-elle.
À l'intérieur des États-Unis, la guerre contre la drogue est devenue un outil de « contrôle des quartiers pauvres de centres-villes, habités par des minorités ethniques », poursuit-elle. Elle rappelle qu’historiquement, chaque drogue a été associée à une communauté aux États-Unis, et son interdiction vue comme un moyen de contrôler ce groupe ; que ce soit la marijuana associée aux migrants mexicains dès les années 1920 ou le crack aux Afro-Américains dans les années 1970.
Cette guerre s’est aussi accompagnée d’un changement du rôle des forces de police locales dans les quartiers populaires, dont l’objectif numéro un est dorénavant d’arrêter les consommateurs et les petits trafiquants de drogues. Analysant la guerre contre la drogue comme un outil de contrôle social, Kathleen Frydl conclut que « la réforme viendra d’abord des citoyens, pas du gouvernement ».
C’est précisément ce qui est en train de se passer : dans le Colorado, l’État de Washington, ou encore dans l’Oregon et en Alaska – qui se prononceront par référendum sur la légalisation du cannabis en novembre 2014 –, les politiques en matière de drogue évoluent grâce à des initiatives populaires.
Mais ce mouvement local, nécessairement décousu puisque chaque État réforme à sa manière et à son rythme, n’est pas sans risque. Le danger le plus apparent est celui de voir pulluler des campagnes en faveur de la légalisation reposant essentiellement sur les arguments financiers – « la taxe sur le cannabis rapporte gros » – et libertariens – « Washington n’a pas à me dicter ma conduite » –, mais qui aboutissent à des lois prenant très peu en compte les questions de santé publique.
« Je sais que beaucoup de gens ici sont sensibles à l’argument libertarien, mais il est facile et dangereux. Je ne pense pas que la drogue soit cool et que c’est seulement ton droit de te défoncer. Il me semble que l’État a une responsabilité, il doit fournir des informations honnêtes sur les méfaits de chaque drogue, il doit prendre soin de ses citoyens », jugeait ainsi l’ancien président colombien, César Gaviria, à la New York University.
Pour le professeur de politiques publiques Mark Kleiman, de l’Université de Californie (UCLA), la prise en charge de ces problématiques par l’État central est absolument nécessaire. Décryptant les lois votées dans le Colorado et l’État de Washington (un État qu’il a conseillé sur le sujet), il estime que le cadre juridique mis en place ne fait pas grand-chose pour réduire la consommation de drogues, mais favorise au contraire l’émergence d’une industrie puissante, qui aura bientôt une capacité de lobbying lui permettant d'étendre ses activités avec un minimum de règles.
Seules les autorités fédérales auraient selon lui le moyen de rectifier le tir, en intervenant vite. Reste à voir quand Washington va relever le défi de redéfinir sa politique en matière de drogues et d’identifier un message honnête et efficace sur les risques associés à leur usage. Pour l’instant, la Maison Blanche choisit le silence.
URL source: http://www.mediapart.fr/journal/interna ... -la-drogue
MÉDIAPART – Légalisation du cannabis (4/6). Les impasses de
Modérateur: Aide-Modérateur
1 message
• Page 1 sur 1
MÉDIAPART – Légalisation du cannabis (4/6). Les impasses de
Les nanas sont de sortie !
Jdc Bambata tikiseedbank !
FxYxS
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Les temps changent mais pas la loi !
DONNEZ-NOUS LE POUVOIR
Jdc Bambata tikiseedbank !
FxYxS
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Les temps changent mais pas la loi !
DONNEZ-NOUS LE POUVOIR
-
























jack1 - Extracteur en chef

- Messages: 10693
- Images: 10
- Âge: 11
- Inscription: 02 Juil 2002, 21:45
- Dernière visite: 27 Mai 2025, 21:10
- Localisation: 420 rue marijane -ganjaland
- Sexe:

-
- Karma: 3750
1 message
• Page 1 sur 1
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 3 invités