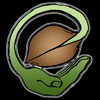MÉDIAPART – Légalisation du cannabis (2/6). Comment aimer le joint est devenu politiquement correct
14 août 2014, 18:13
12 août 2014 | Par Iris Deroeux - Mediapart.fr
URL source: http://www.mediapart.fr/article/offert/ ... 3ed0e566c5
URL source via CIRC fb : https://www.facebook.com/notes/circ/m%C ... 6566155165
Ils sont désormais une majorité d’Américains à soutenir la légalisation de la marijuana. Ils se laissent convaincre par des arguments divers, des bienfaits médicaux du produit jusqu’à la manne financière que représente un cannabis régulé et taxé. Des messages portés par des « faiseurs d’opinion » influents : des associations et lobbies très bien dotés, s’activant sur le terrain pour faire bouger les lignes. Deuxième volet de notre série.
États-Unis, correspondance. Aux États-Unis, l’approche répressive pour lutter contre la consommation et le trafic de marijuana fait de moins en moins recette auprès de l’opinion. Le pays avance sur le chemin de la dépénalisation et de la légalisation. Deux États ont déjà légalisé la plante étoilée en novembre 2012, via des référendums d’initiative populaire : l’État de Washington, à l’ouest du pays, et le Colorado (dont nous avons parlé. Au moins deux autres référendums se tiendront sur le sujet en novembre prochain, en Alaska et en Oregon. Les lignes bougent et même le New York Times s’y met. Le 26 juillet, le comité éditorial du quotidien new-yorkais de tendance libérale annonçait qu’il soutenait la légalisation du cannabis à usage récréatif dans un texte inaugurant une série d’articles dédiés au sujet. Cette prise de position a été jugée à la fois étonnante et courageuse aux États-Unis. « C'est une décision historique qui aura des conséquences historiques », a ainsi estimé Ethan Nadelmann, à la tête de la Drug Policy Alliance.
En parallèle, la légalisation du cannabis thérapeutique, souvent considérée comme une première étape vers la légalisation de son usage récréatif, se propage à travers le pays : vingt-trois États autorisent désormais la « marijuana médicale ». New York est le dernier État à l’avoir autorisée, début juillet 2014, en la limitant cependant à une courte liste de maladies, comme Parkinson ou la sclérose en plaques. La Floride se prononcera sur le cannabis à des fins médicales via un référendum en novembre, et deviendra peut-être le premier État du Sud dit « conservateur » à l'autoriser.
Localement, des mesures sont aussi prises pour désengorger les couloirs des palais de justice et les prisons. Le procureur de Brooklyn, Kenneth Thompson, annonçait ainsi mi-juillet qu’il ne poursuivrait plus les personnes arrêtées pour la première fois en possession de petites quantités de marijuana.
Aujourd’hui, 55 % des Américains se disent ainsi en faveur de la légalisation du produit, contre 16 % en 1987. Seuls 19 % considèrent que la marijuana pose « un sérieux problème aux États-Unis », quand ils étaient 65 % à le penser en 1972, un an après que Richard Nixon déclara la « guerre contre la drogue » et imposa une approche très répressive censée faire baisser la consommation de drogues et lutter contre le trafic, tant aux États-Unis qu’en Amérique latine (lire un prochain article de cette série). Quantité d’études ont documenté l'échec de cette politique. Si la consommation de cocaïne a tendance à baisser, la consommation d’héroïne et de méthamphétamine augmente. Celle de la marijuana aussi : 48 % des Américains disent en avoir fumé en 2013, contre 38 % en 2003, selon le Pew Research Center.
Pour autant, le cadre légal fédéral sur lequel repose cette « guerre contre la drogue » est toujours en place. Il s'appuie sur le Controlled Substance Act de 1970, classant les drogues en fonction de leur nocivité, en interdisant certaines, en régulant d’autres. La marijuana est rangée dans la catégorie 1, parmi les drogues illicites comme l’héroïne, avec un « fort potentiel d’abus » et « dont l’usage médical n’est pas autorisé ».
Ces temps-ci, si mouvement de réforme il y a, il faut donc comprendre qu’il s’agit d’un mouvement d’initiative locale, animé avant tout par des citoyens, qui aboutit à la mise en place d’un patchwork de législations différentes selon les États. Certains optent pour la légalisation de la marijuana à usage médical dans des cas bien spécifiques et très limités. D’autres cumulent marijuana médicale et marijuana à usage récréatif comme le Colorado. D’autres, comme l’Oregon, ont dépénalisé et doivent bientôt se prononcer sur l’usage récréatif… Le point commun entre tous ces États est qu’ils se mettent à chaque fois en porte-à-faux avec les autorités fédérales : aux yeux de Washington, ce qu’ils font est illégal puisque la marijuana est toujours considérée comme une substance dangereuse et illicite.
Leur relative tranquillité sur le sujet tient seulement à la position adoptée par l’administration de Barack Obama. À l’été 2013, Eric Holder, à la tête du département de la Justice, adressait une directive aux agences du pays expliquant que son administration n’allait pas s’en prendre aux citoyens de l’État de Washington et du Colorado, à partir du moment où ceux-ci respectaient les lois locales. Autrement dit, pour le moment, Washington laisse faire. « Leur attitude se résume à “trust and verify” : faire confiance, mais vérifier », analyse Beau Kilmer, à la tête du centre de recherche sur les politiques en matière de drogue de la Rand Corporation.
Comment expliquer cette transformation ? Comment la marijuana est-elle passée dans l’imaginaire collectif américain d’un vice de hippie à un produit acceptable, quasi inoffensif voire vertueux, au point que certains parents l’ont adoptée comme médicament pour leurs enfants (comme nous le verrons dans un prochain article) ?
Lobbying en costume-cravate
Depuis les années 1970, le pays a en fait vu naître des groupes militants et des lobbies réussissant à rendre la marijuana respectable. Le discours pro-légalisation est sorti des marges et de la contre-culture pour devenir politiquement correct. Le tout, en ayant recours à des arguments divers : défense des libertés individuelles, vertus médicales de la marijuana, désengorgement des prisons, manne financière que peut représenter un cannabis légal et taxé… Assez pour séduire des électeurs de tous bords, consommateurs ou non de marijuana, démocrates et républicains, et surtout les jeunes. Ce sont eux qui portent le changement. Selon les sondages de l’université de Quinnipiac, 67 % des 18-29 ans sont favorables à la légalisation, ainsi que 58 % des 30-44 ans.
« La marijuana a une image positive auprès des jeunes, celle d’un produit à la mode comme l’était la cigarette, il y a vingt ans. Cette dernière est désormais moralement condamnable et condamnée, tandis que la marijuana est acceptable, elle est vue par les jeunes Américains comme inoffensive », commente Jenn Kaplan, conseillère santé à la Bronx Preparatory School, grande école semi-publique du Bronx, à New York, elle-même en faveur de la dépénalisation voire de la légalisation si elle est bien régulée.
Dès 1970, quand la weed est encore largement considérée comme une drogue dangereuse et moralement condamnable, une première association se met à militer sérieusement pour que la plante étoilée soit mieux acceptée. Elle se nomme NORML (National organization for the reform of the marijuana laws), et elle deviendra bientôt l’un des plus gros lobbies pro-marijuana à Washington. Keith Stroup, son fondateur, est étudiant en droit à Washington à la fin des années 1960 quand il rejoint le mouvement anti-guerre du Vietnam et commence à fumer du cannabis. Évoluant bientôt dans le milieu du lobbying, l'idée lui vient de créer un groupe de défense des consommateurs de joints. Ainsi naît le premier lobby pro-légalisation.
Inutile de dire qu’à l’époque, la victoire paraît loin : Stroup et ses troupes ont tendance à passer pour un club de fumeurs de joints aux méthodes douteuses, notamment quand ils lèvent des fonds au sein de leur « réseau », lors de fêtes organisées dans la Playboy Mansion, ou auprès de Tom Forcade, trafiquant de cannabis et journaliste underground, qui créera le magazine spécialisé High Times, en 1974. Mais Stroup y croit, portant costume et cravate, il tente de donner à sa cause un visage respectable à Washington.
De l’autre côté du pays, en Californie, des militants d’un autre genre s’activent également sur le terrain, tel Gordon Brownell. Rien ne le prédestine à militer pour la légalisation de la drogue douce : il est républicain et assistant de Richard Nixon dans les années 1960, alors en campagne pour le poste de gouverneur de l’État. Sauf que Brownell tombe amoureux d’une jeune hippie, goûte le cannabis en sa compagnie, ne voit plus trop où est le problème, et décide de résoudre ces contradictions en aidant les hippies à formuler un message sérieux pro-légalisation. Le voilà engagé dans la campagne pour le premier référendum organisé sur le sujet en Californie, en 1972. 33 % voteront en faveur de la légalisation. C’est insuffisant, mais cela permet à Brownell de poser les bases du message libertarien en matière de drogue douce, consistant à dire : « Ce que vous faites chez vous ne concerne absolument pas le gouvernement fédéral. » Un argument pro-marijuana qui s’avère être encore aujourd’hui l’un des plus séduisants auprès d’un électorat de tendance républicaine.
Le combat de ces militants connaît un coup d’accélérateur grâce à la publication d’un rapport, en 1972, dont les conclusions sont pour le moins inattendues. Le très conservateur Richard Nixon avait en effet convoqué une commission pour étudier « les abus de drogues et la marijuana », afin de soutenir sa politique répressive. Sauf que la commission préconise au contraire la décriminalisation de la possession de petites quantités de marijuana.
« Sur la base de notre enquête, nous avons conclu que la société devrait chercher à décourager l’usage du cannabis, en concentrant son attention sur la prévention et le traitement des usagers consommant excessivement. La commission pense que la criminalisation de la possession de marijuana pour l’usage personnel est contre-productive et ne permet pas d’atteindre cet objectif. (…) La politique sociale et juridique actuelle est disproportionnée par rapport aux nuisances individuelles et sociales que peut causer l’usage de cette drogue », lit-on dans la conclusion du document.
Le document ne plaît pas au président, mais permet aux associations comme NORLM de muscler leur argumentaire. Cette dernière se développe, s’impose. Sous la présidence de Jimmy Carter, la voici conviée à venir discuter avec le conseiller du président sur les politiques de contrôle de la drogue. Carter est réceptif, il demandera lui-même au Congrès d’accepter les conclusions du rapport de 1972. Les élus s’y refusent, mais à travers le pays, des réformes sont déjà adoptées. Au milieu des années 1970, le Colorado, le Maine, l’Ohio, l’Alaska et la Californie dépénalisent la possession de petites quantités de marijuana.
Malades et libertariens
Cette parenthèse se referme rapidement. L’ère Reagan s’ouvre en 1981, et la croisade anti-drogue entamée sous Richard Nixon reprend de plus belle. Nancy Reagan lance sa propre campagne anti-drogue « Just Say no », extrêmement médiatisée. De nombreuses associations de parents naissent et s’activent localement, prônant la tolérance zéro à l’égard de la consommation et du trafic de drogues. Ils s’opposent aux efforts de dépénalisation entamés sous Carter au motif que la sécurité de leurs enfants est en jeu. Au même moment, NORML connaît des divisions internes qui l’affaiblissent. Son rôle change, le lobby prend progressivement sa forme actuelle, celle d’un réseau de centres de conseils médicaux et légaux à destination des consommateurs de cannabis.
C’est durant cette époque de tensions et d’hystérie autour des drogues, marquée par les ravages du crack, que le militantisme pro-marijuana change de visage et d’argumentaire. À partir des années 1980 et 1990, la défense du cannabis va notamment passer par la revendication du droit de chacun à se soigner comme il l’entend.
Dennis Peron est l’un des vétérans du combat pour la légalisation de l’usage médical de la marijuana, qui prit son essor en Californie. Depuis qu’il est revenu de la guerre du Vietnam, Peron deale, se fait régulièrement arrêter. C’est aussi un fumeur, qui aime fournir du cannabis à son entourage direct : son compagnon, atteint du sida, et tous ceux qui souffrent des mêmes maux. « L’épidémie du sida faisait des ravages, mes amis mouraient les uns après les autres, et me demandaient quelque chose susceptible de les soulager », nous explique-t-il par téléphone, depuis San Francisco.
Au début des années 1990, il crée alors le Cannabis Buyers Club, afin de fournir du cannabis thérapeutique à des malades. C’est totalement illégal, mais son initiative suscite une telle attention médiatique qu’il est relativement protégé. En 1991, un avis rédigé par ses soins est même adopté par la ville de San Francisco, suggérant à l’État d’autoriser l’usage médical de la marijuana. À partir de 1995, il commence à militer pour que la Californie adopte une loi en ce sens, et planche sur un texte qui pourrait être soumis à un référendum d’initiative populaire.
Mais Dennis Peron se rend compte qu’il manque à sa petite équipe, composée principalement d’anciens hippies, une capacité organisationnelle et des fonds. Il se retrouve donc à faire équipe avec des spécialistes de la communication, comme le consultant Bill Zimmerman, et surtout avec les nouveaux lobbies pro-marijuana en train d’émerger à Washington.
Le résultat ? La campagne menée en Californie en 1996 pour le référendum sur la légalisation du cannabis thérapeutique changera la nature du débat aux États-Unis. Comme le résume le Washington Post en février dernier : « Cette campagne a repositionné la marijuana comme un produit tonifiant en cas de cancer, de glaucome ou pour les malades du sida. Des grands-mères se sont retrouvées à la télé pour expliquer comment le cannabis soulageait leurs maux (...). » Et le "oui" l'emporte avec 56 % des voix.
Qui sont donc ces nouveaux lobbies qui se sont investis auprès de Dennis Peron ? Ce sont d’une part la Drug Policy Alliance et d’autre part le Marijuana Policy Project, deux associations qui sont aujourd’hui au cœur des différentes campagnes locales menées aux États-Unis pour la légalisation de la marijuana à des fins médicales, la dépénalisation, et la légalisation du cannabis à usage récréatif. Leur particularité est qu’elles sont très bien dotées, car financées en grande partie par des milliardaires s’associant à leur combat.
La Drug Policy Alliance naît de la rencontre entre le chercheur Ethan Nadelmann, et George Soros, investisseur milliardaire ayant fait fortune par la spéculation. Nadelmann est fils d’un rabbin, passé par des universités prestigieuses comme Harvard et Princeton, se définissant lui-même comme fumeur occasionnel. Il se politise dans les années Reagan : la réponse politique répressive de l’époque le choque et le pousse à étudier les tenants et aboutissants de la « guerre contre la drogue » (voir un prochain article de cette série). Il en devient l’un des principaux experts. C’est ainsi que George Soros le découvre, à la fin des années 1980. Il accepte de le financer et les deux s’engagent en Californie. George Soros investit quelque 550 000 dollars dans la campagne pour le référendum californien de 1996. Non pas qu’il défende particulièrement les vertus du joint médical, mais parce qu’il estime que les politiques répressives en matière de drogues sont un échec et que la Californie est un bon moyen d’entamer des réformes.
Dans son autobiographie Soros on Soros, Staying Ahead of the Curve, parue en 1995, il estime que la politique américaine consistant à criminaliser la drogue plutôt que d’en faire un problème médical est si inepte que « le remède est souvent pire que le mal ».
Le Marijuana Policy Project, quant à lui, est fondé en 1995 par des anciens de NORLM : Rob Kampia, Chuck Thomas et Mike Kirshner. Rob Kampia en est le président, en poste encore aujourd’hui. C’est un lobbyiste de la mouvance libertarienne : en 2000, il fut candidat du parti libertarien, en lice pour un siège de représentant à la chambre du district de Washington DC. Son association est notamment financée par Peter Lewis, milliardaire à la tête d’un grand groupe d’assurance automobile, Progressive Corporation, se dédiant aux conducteurs « à risques ». Décédé en 2013, Lewis avait lui-même recours au joint médical pour soulager les douleurs causées par une amputation partielle de la jambe. Il estimait comme George Soros que la stratégie répressive était contre-productive. « Nos lois en matière de marijuana sont obsolètes, inefficaces et idiotes », jugeait-il en 2011, dans un entretien au magazine Forbes.
Si, à la différence de la Drug Policy Alliance, le Marijuana Policy Project ne se concentre que sur la marijuana, leurs objectifs sont sensiblement les mêmes : sortir de l’approche ultrarépressive, réduire voire éliminer les lois punitives au niveau local, éduquer le grand public et influencer le Congrès.
Vingt-trois États ont à ce jour légalisé le cannabis thérapeutique
À la suite du succès de la campagne californienne, ces différents groupes soutiendront donc des dizaines d’initiatives à travers le pays. L’Alaska, l’Oregon, l’État de Washington puis le Maine légalisent l’usage médical de la marijuana dans les années 1990. Suivront encore le Colorado et le Nevada en 2000. Vingt-trois États ont désormais légalisé le cannabis thérapeutique. Selon le Pew Research Center, les trois quarts des Américains estiment que la marijuana a bel et bien des vertus médicales.
Les lois adoptées sont cependant souvent plus restrictives qu’en Californie, où le flou du texte initial a donné naissance à un grand supermarché du cannabis thérapeutique. Celui-ci est accessible à quiconque prétexte des maux bénins auprès d’un médecin disposé à fournir une carte de « patient », donnant droit au joint médical. Un demi-million de personnes en possèdent une dans l’État… Une situation que José Mujica, président de l’Uruguay, premier pays à avoir légalisé l’usage récréatif de la marijuana, qualifiait d’« hypocrite », en juillet.
« Le cannabis thérapeutique permet d’avancer sur le chemin de la légalisation car il montre que l’État fédéral se trompe quand il définit la marijuana comme une drogue dangereuse n’ayant aucune valeur médicale. Autoriser le joint médical permet au grand public d’en savoir plus, de mieux se renseigner sur ce produit, et donc de faire avancer le débat », rétorque Art Way, de la Drug Policy Alliance.
Car le but ultime pour ces associations, c’est bien la légalisation de la marijuana. « Notre objectif, c’est de sortir d’une approche de la drogue reposant exclusivement sur la justice criminelle, pour proposer une politique intelligente de santé publique, poursuit Art Way. Il s’agit de changer de paradigme. »
Pour y parvenir, les associations investissent dans des études, des sondages, des conférences, des campagnes éducatives… Elles affinent leur argumentaire en fonction des préoccupations des citoyens, selon les États et les communautés ciblées. Deux arguments s’avèrent particulièrement efficaces aujourd’hui, notamment parce qu’ils sont de nature à convaincre tous types d’électeurs, même ceux qui ne consomment ni n’apprécient le cannabis.
Il y a, d’une part, l’argument selon lequel la guerre contre la drogue et notamment contre la marijuana doit cesser car elle n’a d’autres effets que d’affecter voire de détruire certaines communautés, comme la communauté afro-américaine. La grande association de lutte pour les droits civiques ACLU a ainsi rejoint le mouvement pro-légalisation pour cette raison : c’est devenu une affaire de droits civiques et de lutte contre les discriminations. Elle y a dédié un long rapport, où l’on apprend entre autres que les Afro-Américains ont 3,73 fois plus de chances de se faire arrêter pour possession de marijuana que les Blancs, alors que les deux groupes en consomment autant. Au total, plus de 650 000 Américains sont arrêtés chaque année pour simple possession. Les arrestations pour marijuana composent la moitié des arrestations totales pour possession de drogue.
Le sujet a fait l’objet d’ouvrages et de documentaires fouillés, très bien diffusés. Citons ainsi The New Jim Crow de Michelle Alexander, paru en 2010, et le documentaire The House I live in d’Eugene Jarecki, sorti en 2012 aux États-Unis et pas encore en France. Tous deux s’attachent à montrer comment la guerre contre la drogue a surtout abouti à emprisonner nombre d’Afro-Américains et d’Américains de milieux modestes, payant le prix d’un système judiciaire sévère, où des peines lourdes sont infligées aux récidivistes de délits mineurs. Un système faisant surtout fructifier l’industrie carcérale : les États-Unis comptent quelque 5 % de la population mondiale, mais 25 % de ses prisonniers.
Les médias sont aujourd’hui particulièrement sensibles à ce sujet. Pas une semaine ne passe sans qu’un nouvel article ne l'aborde, schémas et études chiffrées à l’appui. Par exemple dans le Huffington Post ou sur le site Vox. Le New York Times est le dernier en date à avoir publié une enquête sur la justice criminelle et « les injustices des arrestations liées à la marijuana ».
Même la police s’y est mise, quoique timidement, via des associations comme Law Enforcement Against Prohibition (LEAP), composée d’anciens policiers, insistant sur le fait que les forces de l’ordre ont d’autres choses à faire que de se préoccuper de délits mineurs comme la possession de marijuana, et ainsi de se mettre à dos les minorités ethniques.
Enfin, il y a l’argument financier. Il consiste à dire qu’un cannabis légal, régulé et taxé comme l’est l’alcool, peut permettre de remplir les caisses de l’État. Il s’avère particulièrement séduisant depuis 2008 et la crise budgétaire à laquelle font face de nombreux États. Dans le Colorado, la Drug Policy Alliance a ainsi financé une étude se retrouvant au cœur de la campagne pour le référendum de 2012, montrant que la légalisation du cannabis pourrait générer, d’ici 2017, jusqu’à 100 millions de revenus annuels pour l’État. Une somme que le Colorado est encore loin d'atteindre, comme nous l'avons vu dans le premier chapitre de cette série (entre janvier et mai, l'État a levé 23,6 millions de dollars), mais qui eut le mérite de séduire les électeurs.
La vidéo ci-dessous est une publicité diffusée à la télévision, dans le Colorado, durant la campagne pour le référendum sur la légalisation du cannabis. Les sommes générées par le marché illicite sont comparées aux revenus potentiels que générerait un cannabis taxé, « servant à construire des écoles plutôt qu’à des criminels au Mexique ». « For the good guys and not the bad guys (pour les gentils et non les méchants) »
En mai 2013, la Brookings Institution, très sérieux think tank de Washington, publiait un long rapport confirmant ce genre de calcul. Intitulé « La nouvelle politique de la légalisation : pourquoi l’opinion est en train de changer », à lire ici, ce rapport note que l’argument financier est de nature à convaincre de plus en plus d’électeurs.
Et il conclut en estimant que les positions complexes et parfois ambivalentes des Américains sur le cannabis sont susceptibles d’évoluer en fonction de l’expérience du Colorado et de l’État de Washington, les premiers à légaliser. Ces États se savent en effet scrutés. Les militants se doutent qu’un retour en arrière est possible et que d’autres groupes et lobbies s’opposant à la légalisation pourraient reprendre le dessus. Ils savent aussi que le futur de ces réformes locales dépend de la position des élus à Washington. Pour le moment, les autorités fédérales observent, tout en gardant leurs distances avec ce mouvement de réforme des lois encadrant la marijuana. Quelques rares élus au Congrès disent en effet soutenir ce mouvement, mais la majorité d’entre eux ne se prononce pas, estimant que le sujet est encore trop sensible.
Leur dernière crainte, à terme, est que ce mouvement pour la légalisation n’aboutisse à rien d’autre qu’à la naissance d’une nouvelle industrie gigantesque, comme celle du tabac. « C’est quasiment inévitable… Reste à voir combien de temps vont tenir les producteurs artisanaux qui dominent le secteur pour le moment », estime Nathan Jones, chercheur sur les politiques en matière de drogue à la Rice University, au Texas. Pour le moment, si des rumeurs courent sur le possible lancement de cigarettes à la marijuana par l’un des géants du tabac (en juin, le Los Angeles Times revenait sur de tels projets dans les années 1960 et 70), aucune société n’a encore confirmé s’intéresser de près à ce nouveau marché.
URL source: http://www.mediapart.fr/journal/interna ... nt-correct
MÉDIAPART – Légalisation du cannabis (2/6). Comment aimer le
Modérateur: Aide-Modérateur
1 message
• Page 1 sur 1
MÉDIAPART – Légalisation du cannabis (2/6). Comment aimer le
Les nanas sont de sortie !
Jdc Bambata tikiseedbank !
FxYxS
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Les temps changent mais pas la loi !
DONNEZ-NOUS LE POUVOIR
Jdc Bambata tikiseedbank !
FxYxS
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Les temps changent mais pas la loi !
DONNEZ-NOUS LE POUVOIR
-
























jack1 - Extracteur en chef

- Messages: 10693
- Images: 10
- Âge: 11
- Inscription: 02 Juil 2002, 21:45
- Dernière visite: 27 Mai 2025, 21:10
- Localisation: 420 rue marijane -ganjaland
- Sexe:

-
- Karma: 3750
1 message
• Page 1 sur 1
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 1 invité